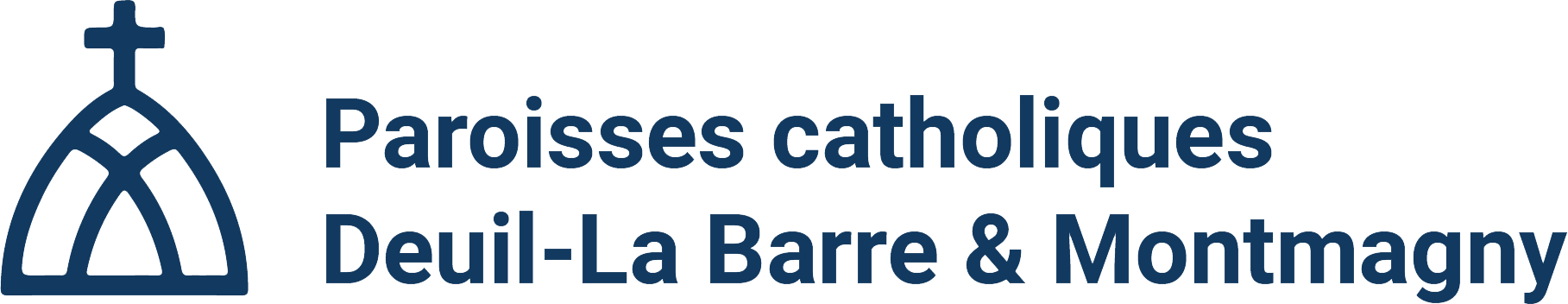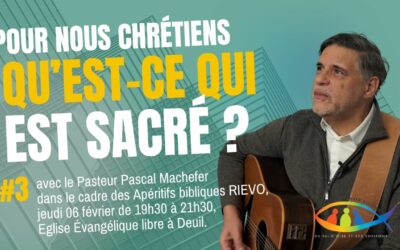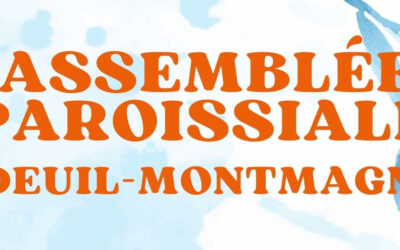La foi, de A à Z
Retrouvez ici les articles publiés dans notre feuille paroissiale et repris ici dans leur intégralité.
Des articles théologiques, comme un condensé de la foi chrétienne…
LA MESSE EXPLIQUÉE DE A à Z
La parution de la nouvelle traduction du Missel romain nous pousse à nous interroger sur la manière dont nous vivons nos célébrations eucharistiques si tant est que notre foi se dit dans notre façon de prier à la messe : lex orandi, lex credendi. Qui n’a pas entendu des jeunes exprimer leur ennui à la messe ? Qui n’a pas remarqué des adultes plongés dans leur missel de poche parce qu’ils se sentent ainsi mieux concernés qu’en écoutant les lectures proclamées ? Que penser de ceux qui vivent la messe par pure habitude ou de ceux-là qui récitent leur chapelet pendant la prière eucharistique ? Dans un ouvrage intitulé «Lettres entre Ciel et Terre » paru en italien aux éditions Cangalli, le P. Ricardo Reyes Castillo rapporte la déclaration à lui faite, à l’occasion d’un dîner, par un ami avocat non pratiquant « J’ai des difficultés quand je vais à la messe, car je me retrouve à dire tant de mots ou à faire tant de gestes dont je ne connais pas la vraie signification ».
Pour essayer de creuser le sens de la liturgie et d’entrer le Mystère de la foi, nous avons aborder chaque semaine, dans la feuille paroissiale, un signe, un rite ou une prière de la messe. Voici en intégralité les articles composés par nos paroissiens et parus dans la feuille paroissiale tout au long des mois.
Fulgence, votre frère.
LA CROIX DE PROCESSION
Dans l’ordre de la procession d’entrée ou de sortie, c’est la croix de procession qui est première. Le cruciféraire (ou « porte-croix ») est précédé éventuellement du thuriféraire (ou « porte-encensoir ») et encadré par deux céroféraires (ou « porte-cierge») pour éclairer le visage du Christ. On porte la croix au début de la messe pour signifier que c’est le Christ qui ouvre la marche, Lui l’alpha et l’oméga, le chemin vers le Père.
La croix est le plus éloquent symbole de l’amour sans répit du Christ qui va jusqu’à la mort pour nous sauver. Depuis la résurrection de Jésus, la croix se dresse désormais sur le monde comme l’Arbre de vie par lequel, le Christ élevé de terre (Jn 8, 28) donne la vie nouvelle à tout homme (Jn 3, 14-15 Jn 19,37) tel le serpent d’airain dont la seule vue épargnait de la mort (Nb 21,4-9).
La croix de procession peut être portée chaque dimanche ou seulement à l’occasion des grandes processions solennelles. Elle peut parfois servir de croix d’autel. En regardant la croix lors des processions et en faisant le signe de croix, je redis à Jésus ma volonté d’être toujours son disciple (Mt 16, 24) et mon désir de l’imiter en mourant à mes refus d’aimer pour me mettre au service de l’autre. Je porte également à Jésus dans ma prière, les nombreuses situations de détresse et je lui demande de faire de moi, un artisan de sa tendresse
P. Fulgence
LES LUMINAIRES
Dans la Bible, nombreuses sont les références à la lumière, à commencer par la Genèse « Et Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. » et chez Saint Jean, Jésus est « la lumière du monde » (8,12). A toutes les époques, il est donc naturel que la lumière naturelle et la lumière artificielle associées tiennent une grande place à la fois dans l’architecture de nos églises et dans la liturgie. La lumière perce à travers les étroites ouvertures des églises romanes et resplendit de toutes ses couleurs à travers les vitraux des églises gothiques. Avant la découverte de l’éclairage électrique, cierges, lampes ou torches, à base de cire ou d’huile d’olive, ont été utilisées. Si pour l’usage quotidien, l’église reste dans la pénombre, gardant ainsi une part de mystère et incitant au recueillement, l’éclairage vise à créer un chemin vers le chœur. En revanche, les lumières se multiplient lors de la grande fête de Pâques et des autres fêtes.
Certains luminaires ont un rôle essentiel dans la liturgie :
À chaque Eucharistie, des cierges (deux ou plusieurs) sont allumés sur l’autel qui représente le Christ et par conséquent, le centre de toute l’action liturgique. Dans la procession d’entrée, les cierges encadrent la Croix et l’évangéliaire s’il est porté en procession. Deux cierges encadrent l’ambon lors de la lecture de l’évangile. Pendant la Communion, une lumière accompagne le Saint Sacrement, dans lequel le Christ est vraiment présent.
La petite lampe toujours allumée à côté du tabernacle signale la présence du Saint-Sacrement
Le Cierge pascal, qui porte plusieurs symboles du Christ (la croix, l’alpha et l’oméga, les quatre chiffres de l’année en cours, cinq grains d’encens) et qui brille pendant les 50 jours du temps pascal comme au cœur des célébrations de baptême (Christ présent à l’entrée dans la vie terrestre), et des funérailles (Christ présent au moment du passage dans la lumière céleste).
Les cierges de dévotion, que l’on allume devant les représentations de la Vierge Marie ou des Saints, signe d’une piété populaire toujours présente (Saint Antoine de Padoue est souvent le plus « illuminé » !). Ces cierges accompagnent aussi les processions de nuit, par exemple lors de la célébration de Notre-Dame de Fatima dans notre paroisse.
Toutes ces lumières dans la liturgie, dans la pénombre des chapelles ou l’éclat des cathédrales, nous invitent à vivre en disciples comme Jésus l’a déclaré : « Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5, 14)
Sources : Dom Robert Le Gall, Dictionnaire de liturgie et site Liturgie catholique des évêques de France
L’ENCENS, l’encensoir et la navette
« Que ma prière devant toi s’élève comme un encens » Ps 141, 2.
L’encens est l’un des présents offerts au Christ par les mages. Dans les rites liturgiques, la fumée de l’encens montant dans le ciel symbolise notre prière. Le parfum de l’encens est un signe d’honneur pour Dieu (croix, autel, cierge pascal, l’évangéliaire…), mais aussi pour l’homme, créature de Dieu (célébrant, diacre, fidèles, corps d’un défunt aux funérailles, …) et pour les dons offerts à Dieu (les oblats: le pain, le vin).
Au cours de la messe, l’encensoir avec des charbons ardents est utilisé en tête de la procession d’entrée et de sortie. Au moment de l’Évangile, on encense l’évangéliaire puis on le balance devant l’ambon pendant la durée de l’Évangile. Le servant de messe qui porte l’encensoir est appelé thuriféraire. Au moment de la consécration, il encense par trois fois trois coups l’élévation de l’hostie puis du calice. La navette est un petit récipient dans lequel se trouve une petite réserve d’encens. Celui qui le tient est appelé le naviculaire.
En regardant la fumée de l’encens et en respirant son parfum à la messe, j’honore Dieu, je lui demande d’agréer ma prière et de faire de ma vie, une offrande d’agréable odeur. Et chaque fois que le thuriféraire m’encense, il me rappelle ‘‘Souviens-toi que ton corps est le temple du Saint-Esprit.’’ (1 Cor.6.19).
P. Fulgence
L’ASPERSION
Dans la liturgie, l’aspersion consiste habituellement à projeter de l’eau bénite sur des personnes ou sur des objets, en signe de purification. L’aspersion principale est celle du baptême : par trois fois, l’on verse de l’eau bénite sur la tête de celui que l’on baptise. On parle également d’« infusion ». De nos jours, c’est la façon habituelle de baptiser, bien que le baptême par immersion soit plus ancien et plus significatif. Être aspergé, c’est se rappeler la source du baptême qui sans cesse coule en nous et nous lave de tout péché. Dans la célébration des sacramentaux, les rites d’aspersion sont nombreux. Ils visent à éliminer des objets que l’on veut bénir toute contagion du mal et à les rendre aptes à toute œuvre bonne.
Au cœur de la Vigile pascale, après la rénovation des promesses du baptême, le célébrant asperge solennellement l’assemblée « en souvenir du baptême » et en signe de purification. Le prêtre plonge un aspersoir (goupillon, rameau de buis ou un petit faisceau de feuillages) dans le bénitier. Un rite analogue peut être accompli chaque dimanche au début de la messe et surtout au temps pascal. Aux messes dominicales, le rite de la bénédiction de l’eau et l’aspersion tiennent lieu de la préparation pénitentielle. On chante Vidi aquam (J’ai vu l’eau vive) au temps pascal, Asperges me, Domine, hyssopo (tu m’aspergeras avec l’hysope) ou tout autre chant joyeux rappelant l’eau baptismale dans le reste de l’année.
Quand on se signe soi-même en prenant de l’eau bénite à l’entrée dans une église, on appelle sur soi une nouvelle effusion de grâce divine.
P. Fulgence
LES SERVANTS D’AUTEL
Pendant les messes, nous pouvons observer la présence des « servants de messe », appelés généralement « servants d’autel’’, autrefois ’’petits clercs’’ ou encore « enfants de chœur » du fait qu’ils sont appelés à intervenir dans le chœur de l’église, aux côtés du prêtre. . Leur présence est discrète mais utile car elle permet d’accompagner le prêtre lors des célébrations et d’aider l’assemblée à prier. Les servants d’autels sont des serviteurs à l’image de Jésus, ils se rendent disponibles les jours de célébration afin d’aider à l’installation et la mise en place des différents linges d’autel (manuterge, purificatoire et corporal), les hosties dans les ciboires, le vin à consacrer dans le calice et allumer les bougies.
Pour le bon déroulement de la messe, le rôle des servants d’autel est multiple : porter la croix de procession, les cierges, le lectionnaire, l’encensoir, la navette, apporter les burettes au prêtre, débarrasser l’autel à la fin de l’Eucharistie notamment. Chacun d’eux sert Dieu en offrant le meilleur de lui-même à l’image de Jésus, le grand serviteur qui s’offre au monde pour nous sauver. Le saint Patron des servants d’autel est saint Tarcisius, un jeune acolyte mort martyr à Rome alors qu’il portait la communion aux prisonniers au IIIème après J-C.
Au cours de nos célébrations, la présence des servants d’autel a une dimension symbolique. Par exemple, lors des processions d’entrée, les servants sont à l’image de l’assemblée qui chemine vers Dieu, avec le Christ notre pasteur, représenté par le prêtre. Par leur service, ils nous rappellent que notre vie doit être au service de Dieu et du prochain. Par leur attitude et leur recueillement, ils aident les fidèles à prier à l’exemple du jeune Samuel qui servait Dieu en présence du prêtre Eli. (1 Samuel 3.1-21).
Lucas Borrhomée
« LE SEIGNEUR SOIT AVEC VOUS »
Le « Dominus vobiscum », traduit par « le Seigneur soit avec vous » est une formule très lointaine apparue au début du IIIème siècle. Ce n’est que deux siècles plus tard, que l’on trouve la trace de la réponse des fidèles « Et avec votre esprit ».
Ce dialogue nous est familier, puisque par quatre fois, la célébration eucharistique le met en œuvre. En s’adressant aux fidèles à travers cette formulation, le prêtre déclare que le Christ est réellement présent dans la communauté.
Ainsi, est relancé le souhait d’une présence active du Seigneur tout au long de la messe : au début de celle-ci, avant l’Évangile, au début de la prière eucharistique et avant la bénédiction, pour nous inviter à porter la présence du Christ dans nos vies.
Oui, la grâce du Seigneur est sur nous chaque jour. En la portant au quotidien, nous sommes invités à suivre ses pas et à porter en nous son amour. Cet amour qui nous permet d’être en paix avec nous-mêmes et avec les autres.
Cette présence, à chacune de nos célébrations et dans toute notre vie, est alors une immense force pour avancer avec la grâce de Dieu.
Félicie DA SILVA
LA PAIX SOIT AVEC VOUS
Au début de la Messe, après « le signe de la croix », le Célébrant salue tous avec des formules à son choix : « La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit-Saint, soient toujours avec vous » ; ou bien « Le Seigneur soit avec vous » ou alors : « Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ soient toujours avec vous ». Vous avez dû remarquer que lorsque c’est l’évêque qui préside la Messe, il salue les fidèles en disant : « La paix soit avec vous ». Toutes ces formules sont très profondes, mais je voudrais vous parler aujourd’hui de la formule dite par l’évêque : ‘La paix soit avec vous’. Lorsque Jésus apparaissait à ses disciples après sa résurrection, il leur disait : la paix soit avec vous (Jn 20,19-20 ; Lc 24,36 et Mt. 28,9). Ce n’est pas seulement l’évêque qui souhaite la paix. Entre la consécration et la communion, soit l’évêque, soit le prêtre, soit le diacre souhaite la paix à tous. Cette paix que Jésus a promise à tous, ce n’est pas la paix selon la conception du monde, mais la paix de la réconciliation avec Dieu par la rédemption de Jésus sur la croix. Jésus présent sur l’autel par son Corps et son Sang, c’est lui qui donne cette paix aux fidèles, souhaitée par l’évêque au début de la Messe.
La paix chrétienne est fille de la foi. Quand nous croyons à la Parole de Jésus, le guide sûr qui conduit au Père, nous pouvons vivre de la paix du Christ. Cette paix, on la découvre chaque jour, on la reçoit du Christ à chaque Eucharistie. Le Concile Vatican II nous dit : « La paix n’est pas une pure absence de guerre et elle ne se borne pas seulement à assurer l’équilibre des forces adverses ; elle ne provient pas non plus d’une domination despotique…La paix n’est jamais chose acquise une fois pour toutes, mais sans cesse à construire ».
Mgr. José-Maria PINHEIRO, évêque émérite de Bragança Paulista (Brésil) en retraite à Pontoise.
L’ACTE PÉNITENTIEL
Cet acte est avant tout une acclamation au Seigneur pour lui montrer qu’on veut l’accueillir, et on le fait en reconnaissant notre besoin de sa miséricorde. Différent du pardon reçu dans le sacrement, ce repositionnement humble « pardonne » en aidant à trouver ou à retrouver une attitude plus juste par rapport à Dieu, à soi-même et aux autres. En nous poussant à nous adresser expressément à nos frères et sœurs rassemblés autour de nous, la précision nous empêche de rester dans une attitude hautaine et froide ou abstraite ; elle peut nous encourager à préparer une demande de pardon à l’un ou l’autre… Et parce que les autres font pareil, nous voilà poussés ensemble à nous tourner humblement vers Celui qui, toujours plein de miséricorde, attend patiemment que nous nous disposions à l’écouter et à nous nourrir de son eucharistie.
Quatre formes de l’acte pénitentiel sont possibles.
- La première est le « Je confesse à Dieu », dit par toute l’assemblée, où nous sommes aussi invités à prier tous les uns pour les autres. Avec la nouvelle traduction du Missel romain entrée en vigueur le 28 novembre 2021, il y a les modifications suivantes : je reconnais devant vous, frères et sœurs; je supplie la bienheureuse Vierge Marie; et vous aussi, frères et sœurs.
Le prêtre dit alors (cette même formule est reprise après les autres formes d’acte pénitentiel):
« Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen »
On dit ou on chante ensuite un Kyrie court (on ne dit qu’une seule fois l’invocation) :
Kyrie eleison (« Seigneur, prends pitié »)
Christe eleison (« Christ prends pitié »)
Kyrie eleison (« Seigneur, prends pitié »)
Outre le Je confesse à Dieu, trois autres formules de prière pénitentielle expriment la volonté de nous aider les uns les autres à nous tourner plus fermement vers le Christ :
- Un dialogue entre le prêtre et l’assemblée : deux versets, chacun appelant une réponse, ce dialogue étant suivi du Kyrie, eleison, court, dit ou chanté :
Prends pitié de nous, Seigneur.
Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
Et donne-nous ton salut.
puis le prêtre dit : « Que Dieu tout-puissant nous fasse…puis on chante – ou l’on dit – le Kyrie.
- Trois invocations plus développées, chantées ou dites, suivies chacune du « Prends pitié » ou du « Kyrie, eleison » repris par l’assemblée ; par exemple :
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi :
Seigneur, prends pitié de nous. / Seigneur, prends pitié.
O Christ, venu appeler les pécheurs :
O Christ, prends pitié. / O Christ, prends pitié.
Seigneur qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous :
Seigneur, prends pitié de nous. / Seigneur, prends pitié.
puis le prêtre dit : « Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…
- La bénédiction de l’eau et l’aspersion, particulièrement au cours du temps pascal. Ce signe nous invite à « replonger » dans notre baptême.
Puis le prêtre prononce la prière pour le pardon propre à l’aspersion d’eau bénite :
« Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son Royaume. Amen »
P. Fulgence
« LE KYRIE ELEISON »
Composé de mots venus du grec ancien, le ‘‘Kyrie eleison’’ est une formule qui signifie « Seigneur, prends pitié ». C’est un chant par lequel, l’assemblée acclame Dieu pour sa miséricorde (Ps 4, 2 ; 9,14 etc.) à la fin de l’acte pénitentiel à moins qu’il n’ait déjà été inséré. On le trouve dès le 4ème siècle dans la liturgie chrétienne comme réponse de l’assemblée dans des litanies surtout dans les Églises orientales.
En 598, le Pape Grégoire 1er dit Grégoire le Grand ajoute l’invocation « Christe Eleison » et l’usage se répand progressivement dans toutes les célébrations eucharistiques et dans les litanies des saints. En principe, chaque acclamation est donnée deux fois, mais l’Instruction Générale du Missel Romain permet explicitement qu’elle soit répétée davantage lorsque les circonstances le suggèrent. On retrouve aussi l’acclamation ‘‘Kyrie eleison’’ accompagnée d’une intention de demande de pardon ou encore sous une forme plus développée faite d’invocations ou ‘’tropes’’, qui remplace alors le « Confiteor » (je confesse à Dieu).
Le ‘‘Kyrie eleison’’ est une invocation du chrétien désireux de se disposer spirituellement pour vivre une communion vraie avec le Seigneur. Le chanter de tout son cœur, c’est faire mémoire de la miséricorde divine dans nos vies.
P. Fulgence
GLORIA
« Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. », « lisons-nous dans l’Evangile de Luc (Lc 2, 13-14)
Ces paroles qu’entonnèrent les anges dans la nuit de Noël à Bethléem, sont reprises dans une hymne religieuse, dite « hymne angélique », écrite en grec d’abord, puis introduite progressivement dans la liturgie romaine à partir du VI°S, et en tout premier pour la messe de la Nativité. Elle fut un temps réservée au pape et aux évêques. Aujourd’hui le Gloria est récité, dialogué, ou chanté aux messes dominicales et à toutes les fêtes et Solennités, à l’exception des temps de l’Avent et du Carême.
Après le kyrie, l’Assemblé chante le « Gloire à Dieu », cette hymne d’allégresse, s’adressant aux personnes de la sainte Trinité. Notre louange s’adresse d’abord à Dieu le Père tout puissant, le Roi du ciel, puis à son fils Jésus le Christ en une longue supplication, enfin, presque de façon anecdotique au Saint-Esprit. Glorification au Père, supplication adressée au Fils s’entremêlent, faisant ressortir le caractère du sacrifice eucharistique offert pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Adoration « Nous te louons », supplication : »Prends pitié de nous », confiance « Reçois notre prière », ainsi se manifeste notre foi.
P. Fulgence
LA COLLECTE OU PRIÈRE D’OUVERTURE
Trois oraisons ponctuent le déroulement de la messe : la prière d’ouverture, la prière sur les offrandes et la prière après la communion. La première oraison est également appelée « collecte » du fait qu’elle rassemble la prière de toute l’Église et les prières de tous les fidèles. C’est pourquoi, après l’invitation à la prière adressée aux fidèles en ces termes ‘‘Prions le Seigneur’’, le prêtre-célébrant est tenu d’observer un temps de silence que chacun des fidèles remplit en exprimant à Dieu dans son cœur ses intentions particulières. Il est préférable de la chanter plutôt que de la réciter.
Instructive et indicative du sens de chaque liturgie eucharistique selon le temps liturgique, la collecte fait mémoire des merveilles de Dieu pour les croyants, elle redit aux baptisés les raisons qui motivent la prière de l’Église ainsi que leurs demandes légitimes et enfin, elle supplie Dieu d’accorder à l’Église et à ses membres ses dons pour cette vie et pour l’éternité. Le prêtre chante la collecte les mains étendues et la conclue les mains jointes par la formule longue « Par Jésus Christ,……. pour les siècles des siècles »; soit, si la collecte s’adresse à Dieu le Père, mais avec mention du Fils à la fin : « Lui qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. »; soit, lorsque la collecte s’adresse au Fils : « Toi qui vis et règne avec Dieu le Père dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. ». Tous répondent par un vigoureux Amen qui exprime notre confiance en Dieu et notre assentiment à la prière de l’Église. Il convient d’éviter tout déplacement de servant ou de lecteur avant la fin de la collecte.
P. Fulgence
PAROLE ET PAIN : ambon et autel
L’architecture mais aussi le mobilier de nos églises ont non seulement une fonction mais aussi un sens théologique. Il en est ainsi de l’ambon et de l’autel, présents dans toute église, dont on retrouve dans l’étymologie un même sens : « autel » vient du latin « altus » qui signifie « élevé » et « ambon » du verbe grec « anabainein » qui veut dire « monter ». Cette idée de « monter » est très présente dans la Bible; ainsi Jésus prêche-t-il sur la montagne ou bien monte sur une barque.
1) l’autel
C’est la table consacrée où le prêtre célèbre l’eucharistie, mémorial du sacrifice de Jésus : la nappe blanche figure son linceul et les cinq croix de consécration sont les cinq plaies. Sacrificielle, cette table est aussi conviviale puisque c’est autour d’elle que se rassemble la communauté des croyants, surtout depuis la réforme liturgique de Vatican II : le célébrant est désormais face à l’assemblée. L’autel, le plus souvent construit en pierre, est aussi depuis cette période d’une conception plus dépouillée mais il a toujours droit aux gestes de vénération du prêtre et des fidèles.
2) l’ambon
Ce mot est moins connu des fidèles. L’ambon est tout simplement l’emplacement surélevé où montent ceux qui, dans la liturgie, spécialement au cours de la messe, ont à faire une lecture. C’est là aussi que se place le prêtre pour l’homélie ou pour dire la Parole de Dieu. Pour annoncer la Bonne Nouvelle, il est en effet essentiel d’être bien vu et entendu de tous, comme Jésus lors du Sermon sur la montagne.
Ambon et autel dans le chœur de nos églises, « Parole et Pain » ainsi au cœur de notre foi.
Françoise Feuillet
ET LES FLEURS ?
Pourquoi des fleurs dans nos églises ? Pourquoi certaines couleurs ? Pourquoi à des endroits précis (autel, ambon, baptistère, cierge pascal, statue de Marie ?)
Quand nous sommes invités, quand un événement est à souhaiter dans nos familles, quand nous souhaitons donner « un air de fête » à nos maisons…. nous mettons, nous offrons des fleurs pour honorer ceux que nous aimons. Le Pape François dans Laudato Si (n° 69 et 85) : « Se servir chrétiennement du symbole naturel, de beauté gratuite et de louange que les fleurs portent en elles, c’est contempler la création, c’est écouter son message, c’est entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence. »
Dans nos églises, maisons de Dieu, nous aimons mettre des fleurs selon les célébrations, les fêtes, les événements, les saisons. En effet, par elles, nous répondons à l’invitation qui nous est faite de venir, ensemble, chanter la louange de Dieu. Le bouquet est louange, action de grâce pour la création tout entière, prière, moyen pour conduire du visible – ce qu’il est -, à l’Invisible, le Seigneur Créateur. Il doit conduire notre regard vers plus grand que lui, vers cet Autre que nous venons rencontrer à la messe. Il participe à la liturgie qui, elle, demeure première.
Chacune des fleurs représente toute notre semaine devant Dieu, nous sommes là présents grâce à notre offrande faite « Pour le fleurissement des églises »… On peut y penser.
Nous sommes loin de la simple décoration.
Françoise Singre pour les membres des équipes de fleurissement des deux églises
(Source « Fleurir en liturgie » Service national de la Pastorale Liturgique et sacramentelle – CEF France)
LES POSTURES LITURGIQUES debout, assis, à genoux et leurs significations
La foi chrétienne est une fois incarnée. Les attitudes corporelles que la liturgie fait prendre aux fidèles construisent l’être croyant. Elles engagent notre corps dans une aventure intérieure, une aventure spirituelle.
La position assise
Assis, c’est la position de l’écoute, de l’assimilation, de la méditation. C’est l’attitude du disciple qui se laisse enseigner : « Marie, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole » (Lc 10,39). On est assis pour écouter les lectures, pour chanter le psaume ou le chant de méditation qui les sépare ; on est levé pour l’évangile, mais on s’assoit pour l’homélie, pendant la préparation des offrandes.
La position debout
La position debout est propre à l’homme (homo erectus) ; elle est un signe de sa noblesse, au milieu de toute la création. Elle est l’attitude de l’homme ressuscité, à l’image du Christ debout à la droite du Père. Marque de respect, la station debout évoque aussi l’élan du cœur. Elle exprime la disponibilité de l’homme à la rencontre avec son Dieu, son attention humble, son désir de rejoindre le Seigneur (cf. Ne 8,5; Lc 18,10; Mc 11,25). A la messe, l’assemblée est debout lors du chant de l’acclamation (alléluia) et pendant la proclamation de l’Évangile, soulignant ainsi sa différence avec les autres lectures, c’est le Christ lui-même qui s’adresse à nous. Au numéro 62 du PGMR, on lit « l’assemblée des fidèles accueille le Seigneur qui va leur parler dans l’Évangile, le salue et professe sa foi en chantant. L’acclamation est chantée par tous debout ». On se lève pour les prières, les louanges, les acclamations (Gloria, Alléluia, préface, Sanctus), la profession de foi (Credo), la Prière eucharistique, la Prière universelle.
Le fléchissement du genou
Fléchir le genou est un acte d’adoration, exprimant l’hommage de tout le corps. La génuflexion est un geste ponctuel, telle la génuflexion devant le tabernacle, ou en entrant dans l’église. La génuflexion ou l’inclination avant de recevoir la communion est une marque de révérence devant le corps du Christ. Elle ne doit pas rompre le mouvement de procession qui signifie la marche de l’Église vers le Seigneur.
L’agenouillement
L’agenouillement est une attitude spontanée que prend l’homme quand il veut marquer son adoration, son imploration ou son repentir. Se mettre à genoux est une attitude pénitentielle, une attitude d’humilité, de repentir au regard du pardon que Dieu nous donne par le Christ. C’est également devenu une attitude d’adoration. Au numéro 43 du PGMR, on lit « Les fidèles s´agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé, l´exiguïté des lieux ou le grand nombre des participants ou d´autres justes raisons ne s´y opposent. Ceux qui ne s’agenouillent pas pour la consécration feront une inclination profonde pendant que le prêtre fait la génuflexion après la consécration ».
Quant à l’Action de grâce que rendent les fidèles après la communion, aucune position ne semble avoir été édictée formellement. Au numéro 88 du PGMR, on lit « lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre et les fidèles, si cela est opportun, prient en silence pendant un certain temps. Si on le décide ainsi, toute l´assemblée pourra aussi exécuter une hymne, un psaume, ou un autre chant de louange ». L’action de grâce se fait dans un silence intérieur, dans la position qui permet à chacun la plus grande intimité avec le Christ, debout, assis, ou à genoux.
PGMR : Présentation Générale du Missel Romain.
Evelyne KLOETZER.
LA LITURGIE DE LA PAROLE : présentation de la structure générale
Quand vous avez reçu de notre bouche la Parole de Dieu, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement : non pas une parole d’hommes, mais la Parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants. (1 Th 2, 13)
Avant de partager le Pain de Vie, l’assemblée des fidèles partage la Parole de Vie, non dans une écoute passive, mais dans un authentique dialogue spirituel, dans lequel le Seigneur s’adresse à chacun et chacune d’entre nous, et où nous lui répondons, ensemble, mais aussi chacun pour son propre compte, par le psaume, l’acclamation, la profession de foi et la prière universelle. Par ce dialogue nous manifestons que la Parole de Dieu est, pour nous, une Parole d’Alliance.
La réforme liturgique après Vatican II a considérablement remanié la liturgie de la Parole en l’ouvrant surtout à l’Ancien Testament. Le lectionnaire offre un choix très large de textes que nous écoutons en semaine, suivant les années paires ou impaires, et le dimanche, selon un cycle de trois années A, B et C.
La première lecture, choisie pour la résonance, le contrepoint qu’elle apporte à l’évangile du jour. Cela nous relie à l’histoire de la foi dont nous sommes les héritiers à travers ses témoins au cours des millénaires.
La deuxième lecture nous introduit dans la foi des premiers chrétiens. Il s’agit le plus souvent d’un texte du Nouveau Testament : une épître (une lettre) ou un extrait des Actes des Apôtres (surtout dans le temps pascal) ou, plus rarement, de l’Apocalypse. Nous y découvrons le témoignage exemplaire, souvent émouvant, de ceux qui ont formé l’Église naissante, qui l’ont organisée, et surtout nous en ont transmis le contenu de foi et les sacrements.
Le psaume qui suit cette lecture est qualifié de responsorial, ce qui indique bien sa fonction : il constitue notre réponse de croyants à la Parole que nous venons d’écouter avec les mots de nos pères dans la foi.
Le psaume (en général un montage de quelques versets) qui suit cette lecture est qualifié de responsorial, ce qui indique bien sa fonction : il constitue notre réponse de croyants à la Parole que nous venons d’écouter ; nous la formulons avec les mots que le Seigneur a mis dans le cœur et sur les lèvres de nos pères dans la foi, avec lesquels tous ont prié : Jésus, Marie, les Pères et les docteurs de l’Église, les moines de tous les temps, et les fidèles qui le veulent, en particulier dans la liturgie des heures.
P. Fulgence
L’ACCLAMATION au cours de la messe
Pendant la messe, la proclamation de l’Évangile est le point culminant de la liturgie de la Parole. Pour marquer l’importance de l’Évangile par rapport aux autres lectures, la proclamation de l’Évangile est encadrée par une acclamation avant et après. Dans cet article, nous allons découvrir le sens et la signification de l’acclamation et de L’Évangile, les rites et les gestes liturgiques qui les accompagnent ainsi que les dispositions du cœur nécessaires pour une fécondité spirituelle.
Dans la messe en semaine où il n’y a qu’une seule lecture, l’acclamation avant l’Évangile se fait juste après le psaume. Et dans la messe du dimanche ou des fêtes solennelles où il y a deux lectures, l’acclamation avant l’Évangile vient directement après la deuxième lecture. En semaine comme les dimanches, le diacre ou le prêtre qui a lu l’Évangile conclut la lecture en invitant l’assemblée à acclamer de nouveau la Parole de Dieu.
Il y a deux acclamations. Le première acclamation a lieu avant l’Évangile. Les fidèles se lèvent et se tiennent débout pour chanter avec joie Alléluia. L’acclamation est un acte qui a une valeur en lui-même. C’est un acte d’accueil du Seigneur et de sa parole. C’est également un acte d’ouverture du cœur, de disponibilité pour se laisser transformé par l’Évangile. En dehors du carême, les fidèles chantent alléluia pour manifester la foi et la joie d’accueillir et de saluer le Seigneur qui parle et qui se révèle dans l’Évangile. L’alléluia est suivie d’un verset du lectionnaire. L’acclamation avec alléluia est généralement chantée. Pendant le carême, on ne chante pas « Alléluia ». Cependant, l’acclamation est maintenue avec des paroles propres qui sont proposées dans le lectionnaire.
La deuxième acclamation a lieu juste après la proclamation de l’Évangile. Le diacre ou le prêtre qui a proclamé l’Évangile invite l’assemblée, qui est encore débout, à acclamer de nouveau la parole de Dieu en chantant ou en disant « Acclamons la parole de Dieu ». Et tous les fidèles présents répondent par la louange en disant ou en chantant : « Louange à Toi Seigneur Jésus ».
P. Fulgence
LA PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Pour marquer l’importance de l’Évangile, sa proclamation se distingue des autres lectures. Toute l’assemblée qui était assise pendant les autres lectures se lève et lance l’acclamation de joie en chantant alléluia sauf pendant le carême. L’Évangile est proclamé par un diacre ou un prêtre. Il peut faire la procession portant l’Évangéliaire avec les servants d’autel (les porte-cierges et le thuriféraire).
La proclamation de l’Évangile commence par le dialogue. Il peut être chanté ou lu. Le diacre ou le prêtre qui proclame l’Évangile s’adresse à l’assemblée en chantant ou en disant : « Le Seigneur soit avec vous ». L’assemblée répond avec enthousiasme : « Et avec votre esprit ». Le lecteur de l’Évangile poursuit le dialogue en indiquant la source de l’Évangile. L’Évangile est une œuvre théandrique : c’est-à-dire une œuvre à la fois divine et humaine. C’est une Parole de Jésus-Christ mais écrite par un homme inspiré qui reste enraciné dans sa culture.
Nous avons quatre Évangélistes : saint Mathieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Le diacre ou le prêtre qui lit l’Évangile chante ou dit par exemple : « l’Évangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu ». Pendant qu’il indique la source, le diacre ou le prêtre fait en même-temps un signe de croix sur l’Évangile. Et les fidèles répondent en chantant ou en disant : « Gloire à toi Seigneur ». Et en même temps qu’ils répondent, les fidèles tracent trois signes de croix : sur le front, sur la bouche et sur la poitrine. Il s’agit d’un geste de foi pour signifier d’abord que nous sommes disposés à écouter attentivement l’Évangile pour le comprendre. Ensuite, que nous sommes disposés à annoncer aux autres ce que nous aurions écouté et compris par notre intelligence. Et enfin, que nous sommes disposés à le vivre et le laisser descendre dans notre cœur pour qu’il transforme nos vies.
Avant la proclamation de l’Évangile, le prêtre peut encenser l’évangéliaire. C’est également un geste de respect et de Vénération. Les servants d’autel portant les cierges allumés se placent de part et d’autre de l’ambon pour manifester que c’est le Christ qui est la Lumière du monde (Jn8, 12), la Lumière de nos pas, la Lampe de nos routes (Ps118,105). Le diacre ou le prêtre termine la proclamation de l’Évangile en invitant à l’acclamation en disant ou en chantant : « Acclamons la parole de Dieu ». Pendant que l’assemblée répond par la louange : « Louange à toi Seigneur Jésus », le prêtre ou le diacre salue de nouveau l’Évangéliaire par un baiser de vénération.
Les fidèles s’assoient pour écouter et méditer l’homélie. Nous verrons ensemble le week-end prochain en quoi consiste l’homélie comme acte liturgique.
Père Savin
L’HOMÉLIE DANS LA MESSE
L’homélie fait partie de l’action liturgique de la messe. A chaque célébration de la messe, Dieu nous invite à deux table : la table de la parole de Dieu et la table de l’eucharistie. Les deux tables sont intimement liés et se complètent harmonieusement. Quelle est la place et le rôle de l’homélie ?
L’homélie n’est un discours ennuyeux où les fidèles se reposent et dorment un peu ! Préparée par un diacre ou un prêtre, l’homélie a une triple-fonction. Proclamée juste après l’acclamation de l’évangile, la première fonction de l’homélie est de favoriser une compréhension large et efficace de la parole de Dieu. Actualisant le message de la parole de Dieu, l’homélie vise à amener les fidèles à découvrir la présence de Dieu et la fécondité de sa parole dans l’aujourd’hui de leur quotidien. La deuxième fonction de l’homélie est de préparer les fidèle à la proclamation de la foi et à la compréhension du Mystère célébré. Il appartient au diacre et au prêtre qui fait l’homélie de mettre en évidence le lien profond entre la parole de Dieu, le mystère eucharistique et la vie concrète. La troisième fonction de l’homélie est alors d’inviter à la mission, au témoignage de la foi, de l’amour et de l’espérance.
Dans la Parole et dans l’eucharistie, les fidèles y puisent la grâce et la force pour bâtir leur paroisse comme une famille. La fécondité et l’efficacité de l’homélie ne dépendent pas uniquement du prédicateur. Le Saint-Esprit qui inspire le prédicateur opère également dans l’assemblée priante. Une personne qui a préparé sa messe en lisant les lectures du jours, en préparant une intention et une offrande à offrir, une personne qui attentive qui participe et ouvre son cœur à la grâce de l’esprit, recueillera plus de fruits que celui qui vient en spectateur.
Père Savin
LA PROFESSION DE FOI : le symbole des Apôtres
Après l’homélie et un temps de méditation, le dimanche et les jours de solennité, le prêtre entonne le credo, qui est chanté ou récité par tous debout, soit ensemble, soit en alternance entre le peuple et la schola cantorum. La récitation du Credo a été généralisée et introduite dans le rituel de la messe au début du XIe siècle. Habituellement, on a le choix entre deux formules: le symbole des Apôtres et le Credo de Nicée-Constantinople. Le rituel et le pontifical prévoient pour certaines célébrations comme le baptême (surtout à la vigile pascale), des formules particulières qui tiennent lieu de Credo.
Dès les premiers temps du christianisme, les chrétiens ont ressenti le besoin de « fixer » la foi au Christ en des expressions puis des textes reconnus voire déclarés « canoniques », c’est-à-dire faisant autorité pour tous. Je crois en Dieu synthétise la foi chrétienne trinitaire et la définit. Le Symbole des Apôtres est « le plus ancien symbole » de la foi chrétienne. Il exprime la très grande autorité de ce texte qui condense de manière exemplaire la foi reçue des apôtres, à défaut d’avoir été écrit par eux.
Notre « Je crois en Dieu » est appelé « Symbole » parce qu’il est le signe de reconnaissance et d’unité entre chrétiens. Il est dit Symbole « des Apôtres » parce que cette « règle de la vérité » remonte substantiellement aux temps apostoliques, sans doute au second siècle, comme en témoigne déjà un commentaire de saint Irénée (115-203 environ) : « Permanence de la foi chrétienne depuis son origine. En tout temps comme en tout lieu, cette foi est la même ; elle se transmet inchangée depuis la première génération, et lorsque nous récitons aujourd’hui notre Credo, c’est bien véritablement sur le témoignage des premiers apôtres de Jésus que nous nous fondons ; c’est ce témoignage, venu jusqu’à nous par une chaîne ininterrompue, qui aujourd’hui encore provoque la réponse de notre foi »
Jean-Baptiste CROCHU.
La profession de foi : le credo de Nicée-Constantinople
Dimanche dernier, nous avions parlé du symbole des Apôtres qui est l’une des trois formes de profession de foi. Nous devons cette très ancienne profession de foi de l’Église de Rome à Rufin d’Aquilée, prêtre romain au 4ème siècle. Il affirme que ce symbole a été rédigé par les Apôtres lors de leur rassemblement à Jérusalem. La rédaction de ce symbole telle que nous la trouvons actuellement dans notre missel date du 6e siècle.
Les Pères de l’Église avaient un grand souci de transmettre en toute pureté l’enseignement du Christ reçu des Apôtres aux chrétiens, et tout spécialement aux catéchumènes de leurs communautés. Ils devaient les préserver des erreurs ou de l’influence de certains courants philosophiques ou spirituels qui pouvaient les déformer et les pervertir. C’est pourquoi, devant les controverses christologiques des premiers siècles et les différentes hérésies, un autre symbole de la foi a été élaboré par l’Église : celui de Nicée-Constantinople, appelé ainsi, puisque sa première partie a été rédigée lors du Concile de Nicée en 325 et la deuxième, lors du Concile de Constantinople en 381.
Le symbole de la foi est une partie intégrante de l’initiation chrétienne. Chaque dimanche, lors de la messe, nous sommes invités à redire notre foi-confiance à notre Dieu, à professer la vérité révélée dans le Christ devant toute la communauté et d’en être des témoins.
Guillaume Thébault.
LA PRIÈRE UNIVERSELLE
La prière universelle est une très ancienne tradition liturgique. Elle trouve son origine dans une lettre de saint Paul à Timothée (1 Tm 2, 1-4). Elle a été remise en valeur par Vatican II (Constitution sur la Sainte Liturgie).
La prière universelle est à la charnière entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. D’un côté, elle est nourrie de la parole de Dieu et en constitue une réponse priante. Après avoir entendu les mots d’amour que Dieu nous adresse, nous pouvons avec confiance épancher notre cœur devant lui. D’autre part, la prière universelle est aussi tournée vers l’Eucharistie : par elle, le peuple présente le monde à Dieu au nom de toute l’humanité et remet entre ses mains bienveillantes, les peines et les joies, les souffrances et les espérances de l’humanité et de l’église. Par notre baptême, nous faisons partie de ce peuple de prêtres et nous exerçons «le sacerdoce commun des fidèles» notamment dans la prière universelle (Vatican II, Constitution Lumen Gentium).
C’est au prêtre célébrant de diriger la prière, de son siège. Il l’introduit par une brève monition et la conclut par une oraison. Le diacre, le chantre, le lecteur ou un autre fidèle énonce les intentions et le peuple, debout exprime sa supplication soit par une invocation commune après chacune des intentions, soit par une prière silencieuse.
Les intentions exprimées habituellement sont:
* pour les besoins de l’Église
* pour les dirigeants des affaires publiques et pour le salut du monde entier,
* pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés,
* pour la communauté locale.
Maddly DELAREBERDIERE
POURQUOI LA QUÊTE ?
L’offrande à la messe s’inscrit dans la liturgie. Elle est partie prenante de son déroulement. Elle a deux dimensions fondamentales : une matérielle et une autre, très importante, spirituelle.
Un sens matériel de solidarité
Saint Paul disait à propos des communautés chrétiennes : « Le premier jour de la semaine (le dimanche) chacun mettra de côté ce qu’il a réussi à épargner » (1 Cor 16,2). Comment pourrions-nous, chrétiens d’aujourd’hui, ne pas être soucieux de participer – selon nos moyens – à l’édification et la vie de l’Église ? Édification et vie matérielle, bien sûr, ressource vitale pour la paroisse ; mais surtout pour l’édification spirituelle par la propagation de la foi et la charité fraternelle. Au-delà de l’indispensable solidarité matérielle, la quête a, par sa place dans la liturgie, une forte dimension spirituelle.
Le sens spirituel de notre offrande
La quête se déroule au cœur de la messe et la remontée des offrandes de quête associée à la procession des offrandes du pain et du vin vers l’autel manifeste la participation de tous les fidèles à l’offrande eucharistique. A l’offertoire, nous apportons au Seigneur notre travail de la semaine, toute notre vie, tout ce que nous avons vécu. C’est le sens liturgique de la quête. C’est la possibilité et la dignité de pouvoir offrir quelque chose de nous-mêmes à Dieu. En même temps que le pain et le vin, le fruit d’une partie de notre travail va être déposé sur l’autel pour que Jésus puisse se rendre présent dans l’Eucharistie : «Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église ».
Notre aumône nous rappelle la grande aumône que le Christ nous fait par le don de sa vie dans le sacrifice eucharistique. Elle nous rappelle aussi que nous ne sommes jamais de simples spectateurs à la messe, mais acteurs ensemble. Ainsi, grâce à nos dons – en argent ou démonétisés par internet -, l’Église a et aura les moyens de sa mission, mission dont nous sommes partie prenante.
France CHABANEL.
LA PRÉPARATION ET LA PRÉSENTATION DES DONS
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel.
Après la quête, la préparation de l’autel par le diacre ou le prêtre, le célébrant tient des deux mains, la patène avec l’hostie puis le calice contenant du vin, un peu au-dessus du corporal posé au milieu de l’autel. Il dit à voix haute ou à voix basse (s’il n’y a pas de chant), la prière de bénédiction « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers: nous avons reçu de ta bonté le pain (le vin), fruit de la terre (fruit de la vigne) et du travail des hommes… » et l’assemblée répond « Béni soit Dieu maintenant et toujours ». Le pain et le vin renvoient à la terre créée par Dieu pour la subsistance de l’homme ainsi qu’au travail de l’homme pour fructifier la terre.
Dans ce geste de présentation des dons, notre cœur retourne à Dieu en louange et adoration, ce qu’il nous a donné. Ce fut dans ce même esprit que Marie et Joseph présentèrent Jésus au temple. Ce fut également l’attitude d’autres croyants bien avant nous dont parle la prière eucharistique I « Comme Il t’a plu d’accueillir les présents d’Abel le Juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t’offrit Melkisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. ». Dans la présentation des dons, nous offrons au Seigneur toute notre vie avec ses joies et ses peines comme le souligne Sacramentum Caritatis, n. 47 : «…dans le pain et le vin que nous apportons à l’autel, toute la création est assumée par le Christ Rédempteur pour être transformée et présentée au Père. Dans cette perspective, nous portons aussi à l’autel toute la souffrance et toute la douleur du monde, dans la certitude que tout est précieux aux yeux de Dieu…».
P. Fulgence
LA GOUTTE D’EAU DANS LE VIN
Avant la présentation du Pain et du Vin qui vont être consacrés pour devenir Corps et Sang du Christ, le diacre ou le prêtre prépare le calice en versant à l’intérieur du vin mêlé d’une goutte d’eau. Ce geste est accompagné d’une prière à voix basse : «Comme cette eau se mêle au Vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis à la Divinité de Celui qui a pris notre humanité ».
L’eau, élément naturel et nécessaire de l’existence humaine, a toujours été riche de significations symboliques. La goutte d’eau que le prêtre ajoute au vin, correspond à l’habitude de couper le vin dans les repas de fêtes juives, celles-ci ont été le cadre de l’institution eucharistique (La Cène). En effet, les vins utilisés à l’époque de Jésus devaient être un peu fort et ils étaient souvent coupés d’eau pour être moins entêtants.
Cette adjonction d’eau évocatrice de l’Eau qui est sortie du côté droit de Jésus et dont Saint Justin fait déjà mention au IIème siècle, a surtout reçu une valeur symbolique et théologique :
– dans l’Église latine, elle exprime davantage l’union de l’Église au sacrifice du Christ. Le vin va devenir le Sang du Christ et l’Eau qui y est ajoutée représente le peuple de Dieu. Comme nous le rappelle Saint Cyprien : « Quand on mêle l’eau au vin dans le calice, c’est le peuple qui ne fait plus qu’un avec le Christ, c’est la foule des croyants qui se joint et s’associe à celui en qui elle croit » (Correspondance, « Epist. 63 », X, 1-3). Ainsi, dans l’eucharistie, le Christ et l’humanité sont totalement unis. Ce mélange de l’eau et du vin signifie alors la destinée éternelle de l’homme.
– Chez les chrétiens orientaux, il rappelle aussi, l’union des deux natures, divine et humaine dans la personne du Verbe incarné. Le vin représente la divinité du Christ et l’Eau représente notre humanité. Dans cet échange sacré, le Christ pour nous sauver, prend notre nature humaine; il l’assume pleinement afin de la diviniser, la rendre plus proche de Dieu.
La MESSE est le sacrifice de toute de l’Église, cette petite goutte d’eau dans le calice, c’est NOUS.
Mérielle Germany-Ezelin
LA PRIÈRE DU PRÊTRE à voix basse et le lavement des mains
A différents moments au cours de la Messe, le célébrant dit des prières à voix basse qui concernent plus spécifiquement le prêtre lui-même. Au moment d’aller proclamer l’Évangile, incliné devant l’autel, il dit : « Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la Bonne Nouvelle ». A la fin de l’offertoire, au moment où le prêtre se lave les mains, sur le côté de l’autel, il dit « lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché ». Une autre prière à voix basse a lieu pendant l’agneau de Dieu mais cette dernière prière n’est plus une demande pour le prêtre mais elle est adressée au Christ, présent dans le pain et le vin consacrés.
Après la préparation des dons, le prêtre adresse à Dieu une humble supplication appelée « secrète » en lui demandant d’agréer les oblats pour le sacrifice : « le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi.». Après cela, il se lave les pouces et l’index avec de l’eau et les essuie avec le manuterge. Si l’encens est employé, il le fait après l’encensement de l’autel et de sa personne. Dans le cas contraire, les servants d’autel lui apportent l’aiguière, le bassin et le manuterge juste après cette prière à voix basse. En se lavant les mains, le prêtre dit « lave-moi de mes fautes…». Avant de s’éloigner, les servants saluent le prêtre et celui-ci les salue également en signe de remerciement. Il est mis fin au chant de l’offertoire ou au jeu d’orgue à ce moment-là.
P. Fulgence
|
Prière secrète du prêtre |
on précise : Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. |
« LE GESTE DE PAIX »
« Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix ».
L’Église implore la paix et l’unité pour elle-même et toute la famille humaine et les fidèles expriment leur communion dans l’Église ainsi que leur amour mutuel avant de communier au sacrement.
Situé entre le Notre Père et la communion, le geste de paix est la conséquence immédiate de la prière qui l’a précédé.
Dans le Nouveau Testament, la paix est liée au mystère du Christ et à l’annonce du salut. L’œuvre du Christ est une œuvre de paix en plusieurs étapes. Elle s’inaugure – à Noël « Gloire à Dieu et paix aux hommes », se poursuit dans la passion « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix », et s’inscrit dans la permanence de la résurrection « La paix soit avec vous ».
La paix du Christ englobe tout le mystère pascal et nous engage, au cœur de notre foi. Comme le Credo est le texte-symbole de la foi, le geste de paix est le geste-symbole qui nous rappelle la nécessité de mettre en œuvre, dans nos vies et dans l’humanité, la Pâque du Christ que nous célébrons.
Quel est l’origine du geste de paix ? Reçue du Christ qui préside à l’assemblée c’est de l’autel que part la paix à répandre dans l’assemblée.
Le geste de paix ne saurait être un geste ordinaire. Il s’agit de se transmettre le Christ, notre paix, celui qui me fait dire « Père » à Dieu et qui fait de nous un même corps dans le pain partagé.
Le geste de paix préfigure la communion eucharistique. De ce fait, dans l’invitatoire le prêtre ou le diacre disent : « Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix ». A cet instant, ce n’est pas le geste qui est en jeu mais la source du geste, le Christ, Prince de la paix, modèle de charité.
En exemple on joint les deux mains, et on accompagne le geste des paroles qui en donnent le sens : « La paix du Christ ».
Il convient que ce geste soit vrai, dépourvu de tout automatisme, habité par le désir intérieur de construire la paix. La liturgie prévoit le geste de paix qui a une grande portée, mais il nous faut veiller à ce que la routine n’en affaiblisse pas le sens. On en usera donc avec justesse et modération.
Ce geste exige aussi de faire la vérité sur nos relations quotidiennes de fraternité et de justice qu’implique l’eucharistie. Il nous alerte sur les mensonges de nos vies, nos incapacités de réconciliation. Comment pouvons-nous êtres corps du Christ si, d’abord, nous ne sommes pas corps fraternel ?
Enfin, ce geste nous rappelle que la paix que nous nous donnons préfigure la paix à venir, celle que nous avons à construire. Nous échangeons, dans ce geste, ce que nous sommes appelés à devenir : des artisans de paix.
Si nous apprenons à faire le geste de paix en vérité, alors, dans la charité du Christ, nous nous donnerons vraiment la paix.
Adeline AMAIZO
Une couleur inhabituelle, LE ROSE
En ce troisième dimanche de l’Avent, nos prêtres arborent une couleur inhabituelle, le rose. Cette exception nous invite à réfléchir sur l’origine et la signification de l’ensemble des couleurs liturgiques. Tout d’abord, dès le IIIème siècle, Clément d’Alexandrie, préconise pour la prière, le port de vêtements réservés, même si ceux-ci ne diffèrent pas réellement des tenues quotidiennes. Ce n’est qu’à l’époque Carolingienne que le « costume » liturgique se constitue, la différenciation des couleurs n’apparaissant qu’aux IXème et Xème siècles. Les couleurs que nous connaissons aujourd’hui datent du XVIème siècle :
- Le Blanc est le symbole de la pureté, de la lumière et de tout ce qui touche à Dieu. Il représente la résurrection et la joie chrétienne. Il est utilisé pendant le temps de Noël et le temps pascal. Nous pouvons aussi le retrouver aux fêtes de la Vierge Marie, des Anges, des Saints et des Saintes qui ne sont pas martyrs ainsi que pour les célébrations des baptêmes et des mariages.
- Le vert est utilisé pour tout le « temps ordinaire », les jours après l’Épiphanie au mercredi des cendres, les jours après la Pentecôte à l’Avent. Il symbolise la Création, la croissance et l’espérance.
- Le rouge est destiné au dimanche de la Passion et au vendredi Saint, à l’ensemble des fêtes de la Passion et aux célébrations liées aux Apôtres et Évangélistes morts martyrs en rappel du sang de leur passion. Il est aussi porté à la Pentecôte pour rappeler « les langues de feu ».
- Le violet est porté lors de certaines messes votives et des funérailles car il représente la couleur du deuil. Également signe de pénitence, il est arboré tout au long du Carême et pour le sacrement de réconciliation. Enfin lors de l’Avent, cette couleur de l’attente, est utilisée car il est un mélange du rouge, iconographie de l’humanité du Christ, et du bleu pour sa divinité.
- Le rose n’est utilisé que deux fois dans l’année, aujourd’hui, 3ème dimanche de l’Avent dit dimanche du « gaudete » (soyez dans la joie) et le 4ème dimanche de Carême dit du « laetare » (réjouissez-vous). Il manifeste la douceur mais aussi l’impatience pour la fête que le violet annonce.
- D’autres couleurs sont utilisées plus rarement en remplacement des couleurs du canon. L’or, couleur de la lumière précieuse peut être utilisé lors des fêtes les plus importantes comme Pâques et Noël. Et, le noir réservé au deuil est très peu usité car le violet lui est préféré.
- Enfin certains rites catholiques orientaux géographiquement restreints prévoient d’autres couleurs comme le bleu ou le gris cendré.
Pierre DUFLOS
Homélie des funérailles du père Guillaume Villatte
Les obsèques du père Guillaume Villatte ont eu lieu ce mardi 1er avril en la catédrale St Maclou de Pontoise. Voici l’homélie prononcée par le Père Edouard George dans laquelle nous retrouvons la figure de Guillaume.
Mgr Bertrand dans la paroisse de Deuil-La Barre
Dimanche 30 mars, la paroisse de Deuil-la-Barre a eu l’honneur d’accueillir Mgr Benoît Bertrand pour une conférence inspirante sur le thème de l’espérance. Au cours de la messe célébrée avec les prêtres et les paroissiens du doyenné d’Enghien-Montmorency, 22 catéchumènes ont vécu leur 2ème scrutin.
Notre évêque à la visite de notre doyenné
Mgr Bertrand sera à Deuil dimanche 30 mars. Dès 9h30 il donnera une conférence de Carême à St-Louis puis célèbrera la messe de 11h avec tout le doyenné. Venez nombreux !
Un appel qui change la vie
Ce dimanche 09 mars les adultes et les jeunes de nos paroisses qui se préparent au baptême vivront la célébration de l’appel décisif : Ils seront appelés par leur nom par notre évêque en vue de leur baptême à Pâques prochain.
Le carême 2025 dans nos paroisses
Découvrez le programme des évènements et des célébrations prévues pendant le Carême et pour Pâques 2025 dans nos paroisses
Jeudi 6 février : Apéritif biblique
Le RIEVO (réseau de Rencontres inter-églises du Val d’Oise) propose ses apéritifs bibliques, les jeudis de 19h30 à 21h30. Premier rendez-vous, le jeudi 06 février sur le thème : Pour nous chrétiens qu’est-ce qui est sacré ? présenté par le pasteur Pascal MACHEFER à partir de 19h30 à l’ÉGLISE Évangélique de Deuil-La Barre
Adieu soeur Lidia
Sœur Lidia BARGIEL est décédée vendredi 03 janvier 2025 à Deuil-La Barre entourée des sœurs de sa communauté. Ses obsèques seront célébrées mercredi 08 janvier 2025 à 14h30, à l’église Saint-Louis de Deuil-La Barre.
Assemblée paroissiale dimanche 12 janvier
Dimanche 12 janvier 2025 de 11h à 16 à St-Louis : Assemblée paroissiale pour les paroisses de Deuil et de Montmagny, messe unique à 11h.
L’Epiphanie, lorsque foi et raison s’embrassent
Le premier dimanche après Noël, nous fêtons l’Epiphanie qui commémore la visite des Rois Mages à l’enfant Jésus. Cette célébration, riche en symboles et en traditions, est souvent tournée vers les trois mages, venus de contrées lointaines. Et si cette fête nous invitait, au-delà de son exotisme, à plonger au plus profond de nous-mêmes, là où raison et foi se rencontrent.
Vente de sapins au profit des lycéens pour le FRAT de Lourdes 2025
Lors du Marché de Noêl les samedis 30 novembre et dimanche 1er décembre à l’église St-Louis de Deuil, vente de sapins au profit des lycéens pour le FRAT de Lourdes 2025.